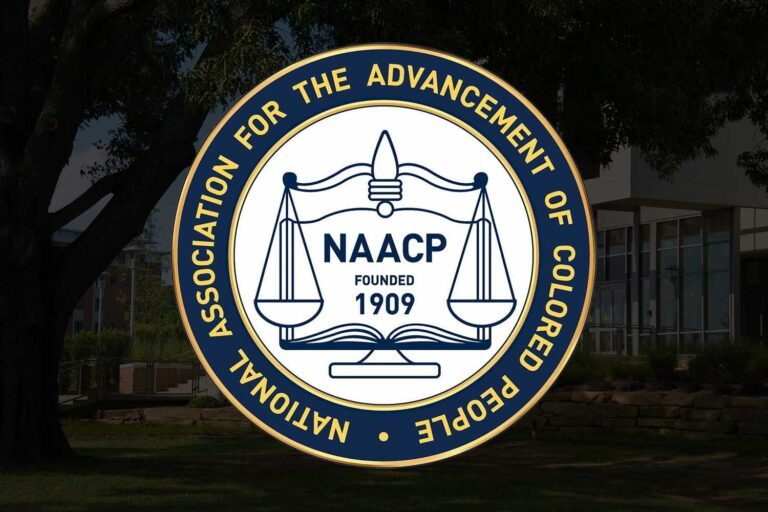Paulette Nardal, intellectuelle martiniquaise, journaliste et militante, a profondément influencé la pensée noire francophone du XXe siècle. Pourtant, son nom reste méconnu du grand public.
Première femme noire à étudier à la Sorbonne, elle a cofondé des espaces intellectuels majeurs et œuvré pour l’émancipation des femmes noires. Redécouvrir son parcours, c’est rendre justice à une figure essentielle de la politique culturelle afro-descendante.
📝 L’essentiel à retenir sur Paulette Nardal
| 📌 Élément clé | 💡 Détail |
|---|---|
| 🎓 Première étudiante noire à la Sorbonne | Études d’anglais à Paris dès 1920 |
| 🖋️ Co-fondatrice de la Revue du monde noir | Publication bilingue en 1931 avec Léo Sajous et René Maran |
| 🏠 Salon littéraire à Clamart | Lieu d’échange entre intellectuels noirs francophones et afro-américains |
| ✊ Militante féministe et anticoloniale | Création du Rassemblement féminin en Martinique après 1944 |
| 🌍 Figure de l’internationalisme noir | Liens avec la Harlem Renaissance et l’ONU |
Paulette Nardal : une architecte de la négritude
Née en 1896 au François en Martinique, Paulette Nardal grandit dans une famille bourgeoise noire cultivée. Son père, Paul Nardal, est le premier ingénieur noir des travaux publics en Martinique. Sa mère, Louise Achille, institutrice engagée, milite dans des sociétés d’entraide féminine. Cette éducation rigoureuse et ouverte au monde façonne son engagement futur.
En 1920, elle s’installe à Paris pour étudier l’anglais à la Sorbonne, devenant ainsi la première femme noire à y être admise. Elle y découvre la vie culturelle parisienne, fréquente le Bal Nègre et assiste aux performances de Marian Anderson et Joséphine Baker. Ces expériences nourrissent sa conscience noire et son désir de créer des espaces de réflexion pour les diasporas africaines.
Avec sa sœur Jane, elle organise un salon littéraire à Clamart, qui devient un lieu de rencontre pour des intellectuels noirs tels que Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, René Maran, ainsi que des figures de la Harlem Renaissance comme Claude McKay. Ce salon favorise les échanges entre les diasporas africaines et afro-américaines, posant les bases du mouvement de la négritude.
En 1931, elle cofonde avec Léo Sajous et René Maran la Revue du monde noir, une publication bilingue visant à promouvoir la culture noire à l’échelle internationale. Bien que la revue cesse de paraître en 1932, elle marque une étape importante dans la reconnaissance de la culture noire francophone.

Paulette Nardal : une militante politique et féministe
Paulette Nardal ne se limite pas à la sphère littéraire. Elle s’engage activement dans la vie politique. Opposée au communisme, elle milite pour une intégration pleine et entière des colonies dans la République française. Elle devient secrétaire du député sénégalais Galandou Diouf en 1934 et s’oppose fermement à l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie fasciste.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle survit au torpillage du navire SS Bretagne en 1939, mais reste handicapée à vie. De retour en Martinique, elle donne clandestinement des cours d’anglais à des jeunes désireux de rejoindre la France libre. En 1944, après l’obtention du droit de vote pour les femmes, elle fonde le Rassemblement féminin, branche martiniquaise de l’Union féminine civique et sociale, pour encourager les femmes à exercer ce nouveau droit.
En 1945, elle devient secrétaire particulière de Ralph Bunche aux États-Unis, futur prix Nobel de la paix. Elle travaille ensuite à l’ONU en tant que déléguée à la section des territoires autonomes, renforçant son engagement pour l’internationalisme noir.
À LIRE AUSSI : Septima Clark : une éducatrice au cœur du mouvement des droits civiques
Une reconnaissance tardive mais croissante
Malgré son rôle majeur, Paulette Nardal a longtemps été marginalisée dans l’histoire officielle de la négritude, souvent éclipsée par des figures masculines comme Césaire ou Senghor. Cette invisibilisation est aujourd’hui remise en question. En 2024, une anthologie intitulée Écrire le monde noir rassemble une cinquantaine de ses textes, mettant en lumière son apport essentiel à la conscience de race et au féminisme noir.
Des hommages se multiplient : une promenade à Paris porte son nom depuis 2019, et elle a été célébrée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Des établissements scolaires en France et en Martinique ont également été renommés en son honneur.
Héritage et pertinence actuelle
Paulette Nardal incarne une pensée politique et culturelle avant-gardiste, liant les luttes contre le racisme, le sexisme et le colonialisme. Son engagement pour une solidarité noire transnationale et son féminisme intersectionnel résonnent encore aujourd’hui, notamment dans les mouvements contemporains comme Black Lives Matter.
Redécouvrir son œuvre et son parcours, c’est reconnaître l’importance des femmes noires dans l’histoire des idées et des luttes pour l’égalité. C’est aussi s’inspirer de son courage et de sa vision pour construire un avenir plus juste et inclusif.